| |
C'est la seconde fois en un an que cette femme de 54 ans bénéficie d'un suivi psychiatrique intensif à domicile, comme alternative à l'hospitalisation. Face à elle, Christelle Vacher, infirmière psy du secteur de Lille-Est (Nord), lui présente son planning de la semaine. Visite chez la psychologue, aquathérapie, consultation avec le psychiatre : chaque journée est ponctuée de deux ou trois rencontres, "mes points de repères", dit Mme Y. En bas de la feuille est inscrit le numéro d'urgence du service, disponible 24 heures sur 24 : "On met tout en oeuvre pour éviter au maximum l'hospitalisation, explique Christelle Vacher. C'est nécessaire en cas de crise, mais il ne faut pas que ça dure, car il y a un côté passif et débilitant à l'hôpital. Personne n'a envie de rester à l'hôpital psy, c'est stigmatisant, ça enfonce les patients encore plus."
L'appel de Nicolas Sarkozy à la multiplication des dispositifs d'enfermement paraît bien anachronique aux soignants de Lille. Aux antipodes de ce repli sécuritaire, le "G21", l'équipe du secteur psy de la banlieue Est, prouve quotidiennement que le retour à l'asile n'est pas une fatalité. Embrassant un territoire de 90 000 habitants, 150 médecins, infirmiers, psychologues et éducateurs suivent chaque année près de 2 200 patients. Sans blouse blanche ni badge distinctif, ils travaillent en relais avec les services sociaux, les organismes HLM et les municipalités. Appartements thérapeutiques, familles d'accueil, suivi intensif à domicile... tout est fait pour que les personnes en souffrance psychique restent dans leur communauté. "On a un panel très large de solutions pour répondre à la situation de chaque patient, explique Yannick Boulongne, cadre de santé. On inverse la logique : ce ne sont pas les malades qui s'adaptent à l'institution psychiatrique, mais nous qui nous adaptons à eux."
Trente années d'un patient travail de partenariat avec les élus, les bailleurs sociaux et la population ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat. C'est l'oeuvre d'une vie, le sacerdoce du chef de service, le docteur Jean-Luc Roelandt, 60 ans. En 1972, tout juste nommé psychiatre, il avait été affecté au pavillon 11 de l'hôpital d'Armentières, le "pavillon de force", là où étaient enfermés les patients les plus dangereux. Il reste profondément marqué par cette expérience asilaire, qui a forgé sa détermination à casser les murs de l'hôpital. "C'était un système épouvantable, bien pire que ce que l'on peut imaginer, se souvient-il. Les droits de l'homme étaient bafoués en permanence. J'ai essayé de changer les pratiques, mais c'était impossible. Il n'y avait pas d'autres solutions que de fermer cet endroit."
En lieu et place du pavillon 11, se trouve aujourd'hui la clinique Jérôme-Bosch, l'unité d'hospitalisation du secteur. Longs couloirs blancs distribuant une vingtaine de chambres, salles de repas et d'activités, l'endroit est quasi désert, presque fantomatique. Conçu il y a vingt-cinq ans pour 60 malades, il n'accueille aujourd'hui qu'une huitaine de patients pour une durée moyenne de sept jours. Ici, pas d'unité fermée ni de chambre d'isolement, l'équipe soignante n'a quasiment jamais recours à la contention. "L'enfermement à vie des malades mentaux, c'est fini, insiste le docteur Roelandt. On consacre la quasi-totalité de nos moyens à l'extrahospitalier pour les faire sortir le plus vite possible. Cela ne veut pas dire qu'on lâche les gens dans la nature, au contraire. Il y a des patients qu'on accompagne à vie. Tout est mis en place pour leur suivi au long cours."
Le résultat est étonnant. Quand on pousse la porte de l'un des 43 appartements associatifs du secteur, où vivent 83 personnes atteintes de schizophrénie ou de graves psychoses, on est accueilli par des sourires, des bonjours, des "je vous fais visiter ?" fiers et empressés. Dans un coquet appartement avec mezzanine vivent Son, 43 ans, Bernard, 59 ans et Marceau, 61 ans. Il y a trente ans, ces hommes auraient été enfermés à l'asile. Aujourd'hui, ils seraient à la rue si le secteur ne les prenait pas en charge. Totalement stabilisés, grâce à la visite quotidienne des infirmiers qui leur délivrent leur traitement, ils se sont fondus dans le paysage. Leur loyer, modéré par un accord avec les bailleurs sociaux, est payé par leurs proches ou leurs responsables légaux.
Casquette vissée sur la tête, son bleu de travail maculé de peinture fraîche, Bernard est le pilier de l'appartement, où il vit depuis onze ans. Il a connu les grands pavillons de l'hôpital d'Armentières pour y avoir été interné de 1986 à 1997. "C'était triste et choquant, tout le monde était mélangé, se souvient-il. On se disait : mais pourquoi je suis là ? Je suis pas fou !" Sa présence chaleureuse et gaie rassure Son, qui parle peu et reste toujours en retrait. D'origine vietnamienne, Son est depuis des années sous le régime de l'hospitalisation d'office avec sortie à l'essai. L'équipe le laisse sous contrainte, car il n'accepterait plus son traitement si on levait la mesure : "Je suis bien ici, avec mes colocataires, dit-il timidement. Avant, j'étais à la rue, je faisais que des allers-retours entre la prison et l'hôpital. Ici, je me sens protégé. Je n'ai pas envie de sortir, je regarde la télé et ça me suffit."
Pour l'équipe du docteur Roelandt, l'intégration des patients dans la cité n'a pas qu'une vocation humanitaire, elle a surtout des vertus thérapeutiques. Privilégier le contact humain plutôt que les murs, c'est affirmer aux patients qu'ils n'ont pas perdu leur citoyenneté, qu'ils peuvent se redresser, malgré leur maladie. "L'hôpital, c'est le lieu de l'anormalité, on peut se permettre d'y être fou : balancer une table devant des infirmiers en blouses blanches, paraît "normal", explique Yvain Piketty, infirmier. La mise en situation réelle, avec des gens comme tout le monde, à l'extérieur, fait qu'on se comporte mieux, on se laisse moins aller." "On responsabilise les patients, on fait en sorte qu'ils soient acteurs de leur prise en charge, poursuit la cadre de santé Yannick Boulongne. On ne veut être ni dans l'assistanat ni dans la victimisation."
Grâce à cet accompagnement très personnalisé, certains patients se relèvent en quelques jours. Qui pourrait croire, en la voyant toute pimpante dans son tailleur rouge vif, rajustant son impeccable brushing blond, que Lydie vivait cloîtrée chez elle, recluse comme un petit animal au milieu des déchets ? Repérée il y a trois semaines par les services sociaux, Lydie, 65 ans, a été hospitalisée une semaine avant d'être hébergée en famille d'accueil. Un cadre rassurant, où elle retrouve peu à peu le goût de vivre. "J'avais tout abandonné. Je ne faisais plus rien chez moi, explique-t-elle, très émue. Etre ici me redonne une famille que je n'ai plus." Gina Alliata, qui l'héberge, aime son travail auprès des patients qu'elle accueille depuis cinq ans. "Je leur apporte la confiance en eux qu'ils ont complètement perdue, indique-t-elle. Ils arrivent tristes, renfermés. Mon bonheur, c'est de les voir repartir avec le sourire."
Cette prise en charge "sur mesure" a un prix, celui de l'engagement total et constant du personnel soignant. Toute la journée, l'équipe du G21 sillonne les dizaines de kilomètres de son territoire, courant de consultation en consultation. "Fonctionner de façon si ouverte implique d'être très présent pour chaque patient, pour éviter tout problème, explique Yves-Marie Develter, cadre de santé. Alors on cavale, ça demande une énergie incroyable." "C'est sûr qu'on prend plus de risques en travaillant dans la cité, c'est moins confortable que rester dans nos bureaux, affirme le docteur Tony Vermeil, un jeune psychiatre qui vient de rejoindre le service. Mais au moins, on est au coeur des problématiques des malades, pas cachés derrière nos murs à s'interroger sur nos pratiques."
Unique en son genre en France, cité en modèle à l'étranger, le service de Jean-Luc Roelandt détonne dans une psychiatrie publique en crise, tentée par le repli sur l'hôpital. "Quand je parle de mon expérience aux autres collègues, ils me renvoient le cliché du Nord, de la solidarité ! s'agace le docteur Roelandt. Mais ça n'a rien voir ! Les gens ne sont pas plus sympas ici qu'ailleurs." Selon lui, la psychiatrie meurt de ne pas s'être suffisamment ouverte sur la cité. "Mon analyse, c'est que la politique de secteur, qui impliquait la multiplication des structures extrahospitalières pour compenser la fermeture des asiles, n'a tout simplement pas été conduite. Les choses se sont faites à la libre appréciation de chaque psychiatre, sans politique de santé mentale globale." Le seul salut serait d'investir massivement dans la cité, non de rouvrir des lits. Comme disait Lucien Bonnafé, une figure de la psychiatrie disparue en 2003 : "Il faut des hommes, pas des murs."
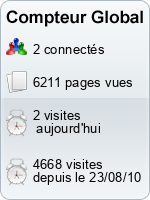
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire