| Alcool : limiter les consommations à risque
L’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs : répondre aux nouveaux modes d’alcoolisation des jeunes
La fréquence des alcoolisations massives des jeunes s’accroît. Ainsi, les hospitalisations pour ivresse dans les services de pédiatrie (moins de 15 ans) ont augmenté de près de 50% en quatre ans.
Tous les alcools sont impliqués dans le « binge-drinking » avec une préférence des jeunes pour la consommation d’alcools forts et de bières.
La législation actuelle n’est plus adaptée à ces nouveaux modes de consommation et doit évoluer.
Actuellement, un jeune de seize ans peut acheter n’importe quel alcool dans une épicerie ou une grande surface et ne peut consommer que certaines catégories d’alcool dans les bars, brasseries….
En augmentant l’âge légal pour acheter de l’alcool, quels que soient les lieux et modes de vente, cette mesure du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » renforce la protection de notre jeunesse. Elle constitue une clarification nécessaire de la réglementation. Elle aura un effet d’entraînement sur l’accès à l’alcool de tous les jeunes, en particulier ceux qui pouvaient faire appel à un camarade plus âgé, mais mineur, pour s’en procurer.
Encadrement de la vente de boissons alcooliques réfrigérées : une meilleure information et une responsabilisation accrue des exploitants vendant de l’alcool frais destiné à être emporté
Les « débits à emporter » (épiceries, grandes et moyennes surfaces…) peuvent vendre des boissons alcooliques fraîches qui sont consommées immédiatement souvent sur la voie publique.
Les exploitants de ces « débits à emporter » ignorent trop souvent la législation sur la vente d’alcool aux mineurs et les moyens de prévenir les consommations d’alcool excessives notamment parmi leur jeune clientèle.
Une mesure du projet de loi vise à imposer à ces exploitants de débits à emporter, le même apprentissage que celui qui est déjà dispensé aux professionnels des « débits à consommer sur place » (bars, brasseries…..).
Cette formation permet de mieux responsabiliser les exploitants des « débits à emporter » et de permettre une application plus effective de l’interdiction de vente aux mineurs.
Interdiction de vente d’alcool dans les stations services
L’alcool au volant est la première cause, directe ou indirecte, de mortalité sur les routes.
Alors que le Gouvernement renforce son action contre la violence routière, des automobilistes peuvent continuer à acheter de l’alcool dans des stations-services en toutes circonstances, même s’ils vont reprendre leur conduite.
La vente d’alcool dans un lieu essentiellement fréquenté par des automobilistes ne sera donc plus autorisée.
Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » interdit la vente d’alcool dans les stations services.
Interdiction des « cigarettes-bonbons »
protéger les plus jeunes de l’initiation précoce au tabagisme
Les « cigarettes-bonbons » ont été conçues pour inciter, de manière sournoise, à la consommation précoce de tabac. Des paquets aux couleurs attractives, un goût sucré et des arômes parfumés favorisent l’expérimentation du tabagisme chez des pré-adolescents en dissimulant l’âpreté des premières bouffées de cigarettes. Le tabagisme reste la première cause de cancer et la première cause de mortalité évitable.
Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » interdit donc totalement la vente de ces cigarettes bonbons sur le territoire.
Des patients diabétiques : un exemple concret d’éducation thérapeutique
Exemple d’une semaine d’éducation thérapeutique
Sources : D’après un article paru dans Equilibre n° 265 (septembre-octobre 2008) et un article à paraître dans Equilibre n° 266 (novembre-décembre 2008).
Avec l’âge, les habitudes alimentaires évoluent, deviennent souvent plus répétitives et il peut devenir utile de revoir le traitement avec le patient. Les patients sont demandeurs d’information avec des motivations très différentes. Joséphine est perfectionniste, elle souhaite approfondir ses connaissances. Elle parvient mal à ajuster insuline lente et insuline rapide. Deux des hommes, Andreï et Francis, ont un diabète tout récent et ont tout à apprendre. Le troisième, Bertrand, après 20 ans de diabète, estime qu’il doit acquérir le moyen de sortir de la « débrouille » approximative qu’il pratique habituellement. La prise en charge doit être adaptée à chacun. C’est ce que permettent les programmes d’éducation thérapeutique du patient.
La première journée est consacrée aux entretiens individuels avec chaque membre de l’équipe soignante - médecin, diététicienne, psychologue… - qui va identifier les problèmes à résoudre.
Durant cette journée, les participants sont également soumis à un jeûne glucidique pour tester la base, et on leur implante sous la peau du ventre une puce qui permettra de mesurer la glycémie en continu durant toute la semaine. Le médecin établit une prescription pour chacun.
Puis les ateliers s’enchaînent au fil des jours. Première information, évidente, importante, et qu’on a pourtant tendance à oublier : « on est tous différent », rappelle le médecin. Ainsi, l’efficacité d’une dose d’insuline peut varier d’un individu à l’autre.
Le travail qui suit pose les bases du contrôle. Deux contrôles sont essentiels : celui du réveil et celui d’avant dîner. Si le résultat du réveil n’est pas satisfaisant, logique, il faut explorer ce qu’il se passe au moment du coucher. De même, pour le résultat avant dîner, s’il n’est pas bon, il faut vérifier la glycémie 4 heures après le déjeuner, moment où elle est censée être correcte…Le médecin n’hésite pas à ajuster les objectifs en fonction de ce que révèle le lecteur de glycémie en continu.
Autre atelier : « quelle dose d’insuline pour manger ? » La complexité apparente s’éclaircit en commençant par se fixer l’objectif à atteindre. « Il faut qu’il soit accessible, prévient le médecin, sinon on risque le découragement ! » La méthode est simple : soigner la glycémie si elle est trop élevée trois ou quatre heures après le repas. C’est donc avec cette idée présente à l’esprit que, au moment de passer à table, on tient compte de sa glycémie de l’instant, de la quantité de glucides que l’on s’apprête à ingérer, de l’activité physique éventuellement prévue… et que l’on choisit sa dose d’insuline.
Reste à savoir évaluer ce que l’on a dans son assiette. Cela ne s’annonce pas facile ! Trois grands plats arrivent : un de carottes cuites, un rempli de coquillettes et le troisième de purée de pomme de terre. L’assemblée est dubitative mais, comme toujours autour de la nourriture, les langues se délient. Chacun est invité à se servir une cuillérée des trois plats. Les différences de quantités sont flagrantes : du simple au double. Le constat est rapidement fait que la traditionnelle cuillérée n’est pas une unité opérationnelle pour évaluer le poids de ce que l’on mange : ça ne marche pas !
Consternation : comment faire ? Puis les participants doivent se servir à leur convenance et aller voir dans l’assiette de l’autre pour donner une évaluation du poids du contenu. Tout le monde participe, l’infirmière et l’aide-soignant et le médecin présents. C’est une question d’habitude à acquérir. Avec l’expérience, on apprend à mémoriser les volumes, à connaître le calibre d’une pomme d’un simple coup d’oeil… Et comme on aura pris soin d’apprendre la quantité de glucides contenue dans 100 g d’aliment…
Le patient repart avec sa propre méthode. S’il a besoin d’un guide malgré tout, l’équipe voit avec lui, pour chacune de ses portions alimentaires, combien d’unités d’insuline il faut, et établit une prescription par portions. Pour celui qui est noyé dans les chiffres, qui n’y arrive pas, l’équipe donne des apports fixes en glucides par repas et calcule les besoins en insuline pour ce repas, plus la dose pour la glycémie si c’est nécessaire.
Joséphine repart rassurée : « Je pensais des choses totalement fausses, par exemple sur le coma diabétique. Je repars contente et rassurée. Sans cela, j’aurais continué à mal gérer mon diabète. Ce serait bien que le discours soit identique partout et qu’on n’applique plus les anciennes méthodes. »
Avant son arrivée, Olga se sentait déprimée : « J’avais eu une formation de deux jours et demi et au total je suis sortie complètement perdue. Là, je pense repartir avec de bonnes bases et pouvoir m’en sortir. Ça va mieux, j’arrive mieux à comprendre la maladie. Je croyais qu’on ne pouvait pas manger tout ce qu’on voulait. J’ai appris à l’atelier diététique qu’on pouvait manger de tout en ajustant les bonnes doses d’insuline. Je n’avais pas eu tous les conseils. »
Le travail en groupe est unanimement apprécié. « L’échange avec des personnes qui ont des diabètes récents ou plus anciens est vraiment très important », constate Andréï. « On n’a pas le même regard, pas le même vécu », renchérit Amélie. « L’aspect le plus efficace de cette formation, c’est d’être à six. On n’a pas du tout les mêmes diabètes. On apprend beaucoup des uns et des autres pour ne pas faire d’erreurs », complète Francis.
De fait, la complicité qui s’est instaurée est palpable. Les téléphones s’échangent, pour prendre des nouvelles, se soutenir mutuellement.
Quant au personnel soignant, il est plébiscité : « L’équipe est géniale, avec des mots simples elle explique très bien les choses, sans hésiter à répéter. Ces professionnels sont vraiment à notre écoute. » |
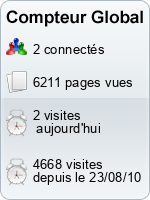
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire