Interview
« Il faut donner les moyens aux hôpitaux »
Mise en ligne : 5 janvier 2009 Claude Évin, ancien ministre de la Santé, président de la Fédération hospitalière de France.
Le déficit hospitalier public atteint 660 millions d’euros. Qu’en pensez-vous ?
Le vote d’un Ondam [1] hospitalier à 3,1 %, inférieur de 1 point à ce qui serait nécessaire pour maintenir les moyens des hôpitaux mais aussi pour appliquer les mesures salariales décidées par le gouvernement, va mécaniquement aggraver les déficits.
La Fhf plaide depuis toujours pour l’adoption d’un niveau réaliste de progression de l’Ondam et pour une maîtrise des causes de sa progression.
Vous chiffrez à 20 000 les suppressions de postes nécessaires à un retour à l’équilibre budgétaire. Le personnel va-t-il devenir une variable d’ajustement ?
Le chiffre de 20 000 n’est qu’une traduction du besoin de financement des hôpitaux. Il faut être lucide : si le personnel représente 70 % des budgets, et si les autres postes de dépenses sont contraints, il est difficile de ne pas toucher à la masse salariale…
Les pouvoirs publics doivent adopter un langage clair, de vérité et de courage, ou donner aux hôpitaux les moyens budgétaires de fonctionner avec leurs effectifs actuels.
Depuis l’entrée en vigueur de la tarification à l’activité (T2A), vous réclamez la reconnaissance des missions de service public. Avez-vous été entendu ?
Hélas non, et ce refus est assez incompréhensible. Au nom d’une idéologie du « tout-tarifaire », on n’a toujours pas, après cinq années, valorisé de manière raisonnable la prévention, l’accueil des urgences, les capacités de réponse aux crises sanitaires, la prise en charge de la précarité… Les études demandées par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) à notre initiative n’ont quasiment pas été entreprises.
Cette situation est d’autant plus grave qu’elle alimente une polémique absurde sur les supposés « surcoûts » du service public hospitalier.
Pour quelles raisons la convergence des tarifs est-elle impossible entre le public et le privé lucratif ?
Parce qu’ils ne font pas les mêmes choses ! En fait, la concurrence n’existe que sur moins d’une centaine de Ghs [2] : pour les autres, souvent peu rentables, seul le service public est là !
Quant aux contraintes, elles ne sont pas les mêmes non plus, qu’il s’agisse du statut du personnel ou du Code des marchés publics. Pour une comparaison équitable, il faut tenir compte de tous ces facteurs.
Que pensez-vous de l’extension du privé lucratif ?
La prise de contrôle d’un nombre croissant de cliniques par des grands groupes étrangers ne peut laisser indifférent. Leurs exigences de rentabilité très élevées peuvent conduire à des abandons d’activités, alors que les schémas d’organisation sanitaire sont construits sur l’hypothèse que l’ensemble des établissements continueront à fonctionner.
Cela est d’autant plus inquiétant que des missions de service public pourront demain être confiées à des cliniques commerciales. Un abandon brutal aurait donc de graves conséquences pour la santé publique, car on ne peut demander aux hôpitaux publics de remplacer immédiatement une offre privée défaillante. Il faut donc construire un mécanisme juridique qui garantisse la pérennité de ces activités.
[1] Ondam : objectif national de dépenses d’assurance-maladie.
[2] Le « groupe homogène de séjour » (Ghs) est censé couvrir les dépenses liées à l’hospitalisation de chaque malade. Les 12 000 maladies recensées sont regroupées en 778 Ghs.
La tarification à l’activité
La tarification à l’activité, ou T2A, attribue à tous les établissements une allocation de ressources fondée sur la mesure de leur activité.
Chaque maladie, chaque patient est affecté d’un coefficient de financement. Le nombre d’interventions conditionne donc le budget de l’établissement, ce dernier se voyant ainsi rémunéré en fonction de son activité. Conséquence : les malades et les affections les plus rentables sont privilégiés.
Le rapport* du Comité d’évaluation de la tarification à l’activité de février 2008 relève les « effets non désirables » de ce principe tarifaire : « un risque moral – fournir des soins surcotés à des patients souffrant de maladies n’exigeant pas de tels traitements ; inversement, gagner en productivité en restreignant l’intensité des soins pour les patients les plus lourdement atteints ; le risque de sélection pure et simple des patients en écartant de la patientèle ceux qui ne seraient pas source d’une rémunération jugée satisfaisante ».
* Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), n° 76, février 2008.
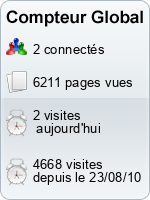
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire