Jusqu’en 1995, six des professions paramédicales avaient une formation cadre qui leur était spécifique. Le décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme cadre de santé, met un terme à ces spécificités en introduisant une formation commune à l’ensemble des professions paramédicales.
L’objectif de cette interprofessionnalité est l’acquisition d’un langage commun, et l’amorce d’un décloisonnement au sein des établissements de santé. Suffit-il d’être regroupé dans une formation commune pour partager des valeurs et un langage commun ?
Les élèves cadres issus de professions médicotechniques ont l’occasion de découvrir, tout au long de cette année de formation, ce qu’est la culture soignante. Et quand bien même, d’un point de vue catégoriel, les manipulateurs en imagerie médicale et les techniciens de laboratoire appartiennent au corps des médicotechniques, il n’en est pas moins vrai que la culture professionnelle des premiers est bien plus proche de celles des infirmiers que de celle des seconds.
Si bien des manipulateurs en imagerie médicale se revendiquent « soignants » à part entière, les techniciens de laboratoires, maillons importants de la chaîne du soin, ne se considèrent pas comme des soignants, mais tiennent à leur catégorie « médicotechnique ». La rencontre de ces deux cultures dans la formation commune des cadres de santé a-t-elle des conséquences positives, nécessaires sur la construction identitaire des futurs cadres de santé ?
Un langage commun : rêve ou réalité ?
Pour favoriser l’acquisition d’une culture et d’un langage communs à tous les cadres de santé, et pour entamer le décloisonnement au sein des établissements de santé, le décret de 1995 prévoit des modalités bien précises de recrutement des cadres pédagogiques dans les instituts de formation des cadres de santé (I.F.C.S.) : « l’équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel pour chacune des professions pour lesquelles l’institut est agréé. »
Mais « malheureusement, cette pluriprofessionalité est plus ou moins effective selon les agréments ministériels obtenus par les IFCS et restera toujours déséquilibrée quoi que l’on fasse : démographie paramédicale oblige. » Cet état de fait est regrettable car l’élève en formation, pour sa construction identitaire de futur cadre de santé, a besoin de repères pour effectuer le passage de sa profession initiale vers celle de cadre.
Relation formateur-formé
L’effet miroir qui se produit entre formateur et « formé » a un rôle important dans ce passage. Les élèves en formation attendent que quelqu’un, à côté d’eux, leur dise qu’ils sont bien là, que c’est bien eux les futurs cadres de santé. Ils veulent confirmation de leur identité, pour pouvoir continuer à progresser dans ce passage, et ne pas se perdre, tourner en rond, voire rebrousser chemin.
Qui mieux qu’un formateur issu de leur profession d’origine peut le faire ? Ne les appelle-t-on pas des « cadres » pédagogiques ?
Le cadre, tel que décrit par José Bleger , comme une limite, un tracé ; ce « cadre » évoque aussi la stabilité du tracé, qui protège ce qui est dedans (les élèves) de ce qui est dehors. Le cadre permet aux étudiants, clairement ou confusément, d’avoir des repères. Il conditionne leur orientation, leur position en tant qu’élève. Il leur permet aussi d’avoir le sentiment d’une identité.
Néanmoins, quelle compétence l’étudiant cadre reconnaît-il à un cadre pédagogique pour évaluer sa progression en tant que soignant, ou que médicotechnique si le formateur n’a pas la même origine professionnelle que lui ?
Identification du formé au formateur
Et que penser de l’identification du formé au formateur ? C’est un vecteur fondamental de la communication entre les individus. La construction de l’identité du futur cadre passe par l’identification. Ce faisant, le formé s’approprie ce qu’il croit être les qualités de l’autre, du formateur auquel il s’identifie. C’est une façon d’entrer dans sa peau. Si l’élève n’arrive pas à s’identifier à son formateur, il peut vivre une angoisse de ne pas être reconnu par lui, et au-delà, une angoisse de perte d’identité.
Ce phénomène relève du mythe cosmogonique, tel que le décrit Mélanie Klein : peur très ancienne liée à la création de l’univers ; nous avons peur de ce qui est en nous et qui nous est étranger. C’est à l’origine de ce qui nous fait redouter l’autre, de ce qui nous en fait faire un étranger.
Construction identitaire
L’étape de la construction identitaire du cadre, étape clé de la formation cadre de santé, aura des conséquences tout au long de la future carrière du cadre de santé.
Pour reprendre la métaphore souvent utilisée qui compare la formation cadres de santé à une grossesse, négliger l’importance de la construction identitaire du futur cadre de santé, c’est un peu comme ne pas surveiller le développement du fœtus en cours de gestation, et être surpris de le voir naître avec une malformation…. Qu’il conservera peut-être toute sa vie !
Pour se construire, l’étudiant cadre de santé doit acquérir certains savoirs. Or « dans le savoir, il n’y a pas que le savoir, intervient aussi la manière dont on l’a acquis, en particulier en matière de durabilité, d’appropriation. »
Cette appropriation du savoir sera d’autant plus facile pour le formé qu’il se retrouve dans le formateur. Selon Micheline Desplebin (2000), directrice de l’I.F.C.S. du C.H.U. de Poitiers, « il a été démontré que les interactions entre pairs construisent un savoir plus stable que la seule interaction avec un expert. » C’est là tout le paradoxe de la formation des cadres de santé, commune à l’ensemble des professions paramédicales.
Comment les apprenants issus de professions médicotechniques se reconnaissent-ils dans les formateurs soignants ? Que leur apportent les interactions avec les infirmières ? La découverte du monde soignant pour certains, une façon de s’approcher un peu plus du patient pour d’autres… Mais faut-il nécessairement être auprès du patient pour contribuer à lui apporter un soin de qualité ?
Le décret du 18 août 1995 se prévaut d’« enrichir les relations de travail et les coopérations entre les nombreuses catégories professionnelles, indispensable à la cohérence des prestations. » L’année de formation cadre de santé a ceci d’enrichissant pour les médicotechniques : transférer les problématiques du monde soignant au monde médicotechnique qui était le leur, et qui le sera à nouveau après la formation.
Car si la formation est commune, la profession d’origine, elle, figure tout de même sur le diplôme de cadre, sous la forme de « mention ». Ceci implique qu’un cadre de santé « mention infirmier » sera affecté dans un service de soins, et un cadre de santé « mention technicien de laboratoire », dans un laboratoire, etc… Comme si, une fois ce langage commun acquis, ce décloisonnement entamé, il fallait soudainement se « recloisonner » : chacun son terrain d’affectation. C’est une gymnastique quasi quotidienne, pour les étudiants issus de catégories professionnelles médicotechniques, d’adapter à leur quotidien de futur cadre les exemples développés par les formateurs : qui dit module de formation dit I.F.S.I. , qui dit évaluation dit M.S.P. , qui dit mémoire d’initiation à la recherche dit mémoire d’initiation à la recherche en soins, et que dire des S.I.I.P.S. , et autre R.S.S. ? Langage commun, certes, mais il semble que parler le « langage infirmier » avant d’entrer en formation constitue un net avantage pour le futur cadre de santé.
Décloisonner, selon la définition de l’encyclopédie Encarta, c’est « réduire les champs de spécialisation, les structures qui entravent la libre circulation des idées. » Réduire un champ de spécialisation, est-ce uniformiser ? Mais alors dans quel sens le faire ? Au profit de qui ? Du patient, certainement…Le décloisonnement implique-t-il que le nombre fasse loi ? Et si décloisonner c’était perdre son identité ?
Le législateur l’avait un peu pressenti, et pour s’en dédouaner il proclame que « l’objectif de décloisonnement poursuivi ne saurait en aucun cas conduire à remettre en cause l’identité de chacune des professions (…) »
Cadres du XXIème siècle : cadres hospitaliers ?
Pourquoi ne pas envisager une formation cadre de santé commune à l’ensemble des cadres de santé, soignants, médicotechniques, administratifs et techniques, comme le suggère Jean Abbad (2001), directeur adjoint des ressources humaines du C.H.U. de Poitiers, dans son ouvrage « Organisation et management hospitalier » ? « Ils (les cadres) doivent, notamment, disposer d’une culture commune, partager les mêmes valeurs, adhérer solidairement au projet collectif et aux stratégies de leur établissement et développer entre eux une communication interactive. »
La formation commune à l’ensemble des cadres ne serait-elle pas le moyen le plus sûr de faire cohabiter plusieurs logiques, de les partager, les comprendre et de faire de la qualité des soins l’affaire de tous, et non plus un privilège réservé aux soignants ?
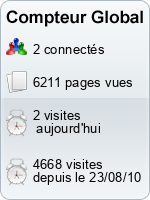
Et aussi sur le groupe PriceMinister : Autres catégories, Jeux Vidéo, Immobilier caen
Consultez la boutique de boris60.
mercredi 7 janvier 2009
Cadre de santé : la formation commune favorise-t-elle la construction identitaire ?
par Catherine Guérin
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire