Les malheureux accidents médicaux intervenus en région parisienne ces dernières semaines ont relancé le débat récurrent sur les moyens accordés à l'hôpital public en France.
Avec 67,5 milliards d'euros en 2008, soit près de la moitié des dépenses d'assurance-maladie, l'hôpital n'a jamais disposé d'autant de moyens. Mais en même temps, on lui demande de plus en plus de choses, parfois contradictoires. En particulier, les CHU - comme l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris - assurent à la fois des activités de pointe de plus en plus spécialisées et une médecine quotidienne de proximité. Les urgences hospitalières sont souvent utilisées comme des dispensaires faute d'un nombre suffisant de médecins conventionnés en secteur 1, et assurent une fonction de « triage » qui ne faisait pas partie de leurs missions premières.
Toutes les conditions sont réunies pour une croissance exponentielle des dépenses : vieillissement de la population, progrès médical, prise en charge socialisée, rigidités organisationnelles (et statutaires) qui rendent difficile le nécessaire travail de réallocation des moyens en fonction de l'évolution des besoins et du progrès médical.
Le financement par dotation globale assurait une rente de situation à certains services installés et freinait le développement des nouvelles thérapeutiques. La tarification à l'activité, qui lie l'attribution des moyens au volume de l'activité de soins et dont les quelques effets pervers peuvent être corrigés, est accusée aujourd'hui d'étrangler l'hôpital public même si le financement complémentaire des missions de service public (les « Migac ») et des fonctions d'enseignement et de recherche (les « Merri ») est important.
Le mode de financement ne peut répondre par lui-même aux questions qui naissent de la tension entre le souci de maîtriser les dépenses et des besoins de santé qui ne peuvent que croître à l'avenir. La résolution de cette tension passe par une double approche, quantitative : quel niveau de cotisations sociales sommes-nous prêts à accepter pour financer le système ; et qualitative : comment mieux organiser des soins qui restent artisanaux et surtout cloisonnés, entraînant à la fois des coûts élevés et des dysfonctionnements dont pâtit trop souvent le patient et qui peuvent avoir parfois des conséquences dramatiques.
Pour être pertinente la réponse à ces deux questions doit se situer dans une perspective de moyen et de long terme. C'est tout l'intérêt de l'exercice prospectif « France 2025 » lancé par le Premier ministre et animé par Eric Besson. Dans le cadre d'un groupe de travail chargé de réfléchir au devenir de l'action publique en 2025, nous avons étudié trois scénarios.
Dans le premier, l'Etat, les professionnels et les patients acceptent tacitement la dérive au fil de l'eau du système de santé. Il conduit aux excès du système américain : médecine technique d'excellence pour ceux qui peuvent payer, performances sanitaires d'ensemble médiocres pour les autres, coûts non maîtrisés pour la collectivité. Aujourd'hui, déjà, l'égalité théorique d'accès est mise à mal par l'inégalité d'accès à la bonne information, les dépassements d'honoraires des médecins dans les cliniques privées et, aussi, par la pratique du secteur privé à l'hôpital.
Le deuxième, proche de la pratique anglaise jusqu'à 2002, donne la priorité à la maîtrise de la dépense des soins remboursés. L'accès aux soins est strictement réglementé, comme l'activité des professionnels de santé. La priorité est donnée à la lutte contre les grandes pathologies. Le confort d'usage est réduit et les files d'attente s'allongent. Ce scénario débouche sur une médecine duale et le développement d'un secteur de soins non remboursés.
Dans le troisième scénario l'Etat accepte la montée de la demande de soins et son foisonnement. Il assure la régulation d'une offre hospitalière publique et privée. Il encourage la recherche dans le cadre européen pour amplifier la prévention des pathologies et du vieillissement. Il pousse particulièrement à l'utilisation des technologies de l'information pour gagner en qualité et en productivité. Il concentre le pilotage national sur les fonctions stratégiques : qualité, égalité d'accès, efficience et pérennité du financement solidaire. L'Etat dispose d'une administration régionale acheteuse de soins qui garantit qualité et efficience par la mise en concurrence des acteurs publics et privés. Les producteurs de soins sont incités à s'organiser entre eux, sur une base industrielle, pour offrir les meilleurs services au meilleur prix. Les assureurs publics et privés sont invités à proposer les solutions les plus économiques. Les professionnels sont associés étroitement à la définition des priorités de santé et des normes de qualité. Le rôle des patients et de leurs associations contribue au contrôle du bon fonctionnement du système de santé.
Ce scénario repose sur un Etat qui commande et assure pleinement sa fonction de pilotage et de régulation, des professionnels et des citoyens responsables et exigeants. C'est possible et c'est nécessaire, mais cela suppose de sortir de l'équation ancrée dans notre inconscient collectif qui veut que action publique égale service public égale emploi public.
L'action publique peut, en effet, prendre des formes diverses : services directement assurés par l'État, délégation à des acteurs privés, ou encore partenariats public-privé. En 2025, il sera essentiel de différencier ces formes d'action sous peine de voir l'État se transformer en un acteur passif aux activités morcelées, ne parvenant pas à répondre aux nouveaux besoins des citoyens.
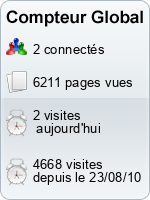
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire